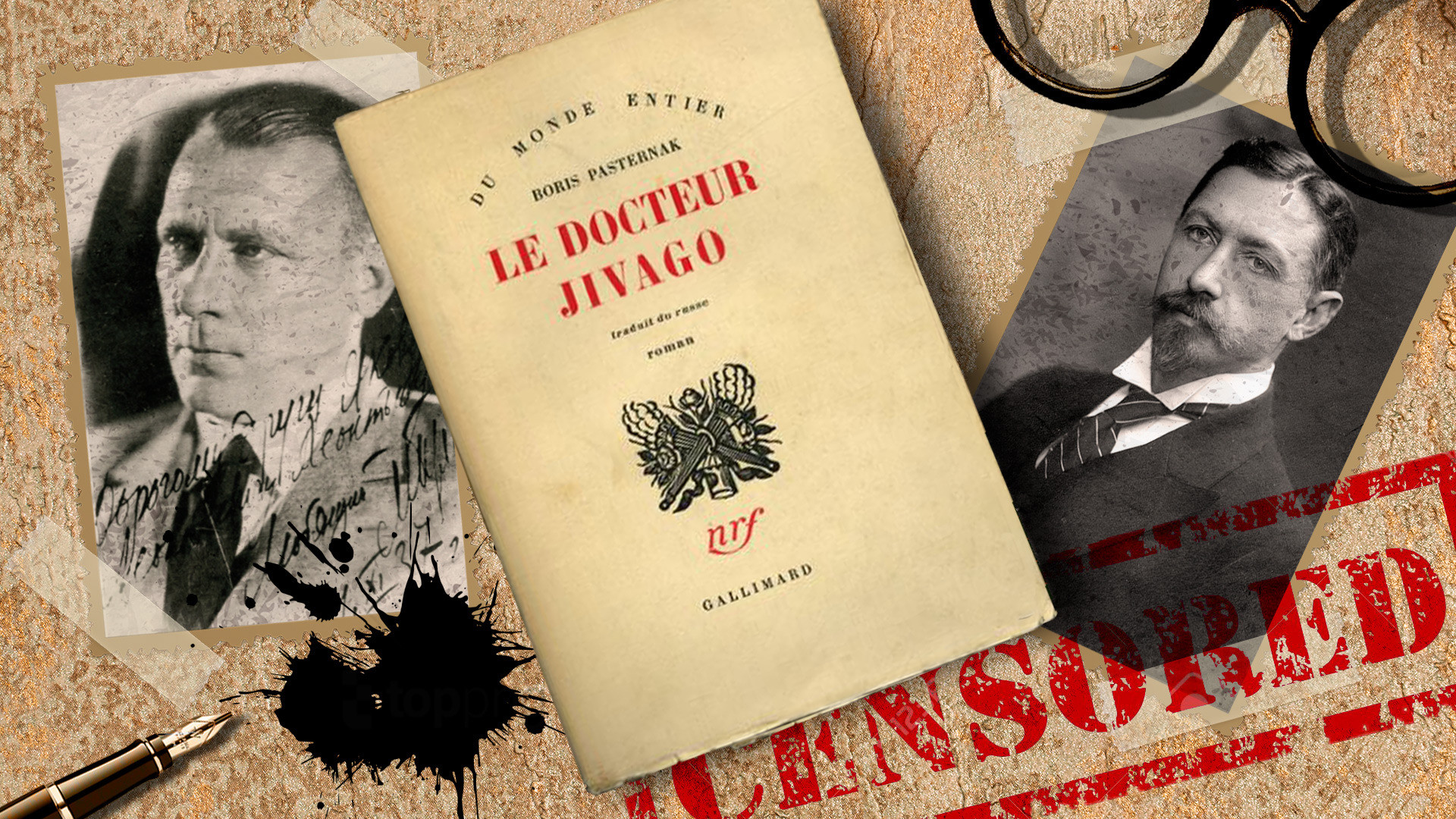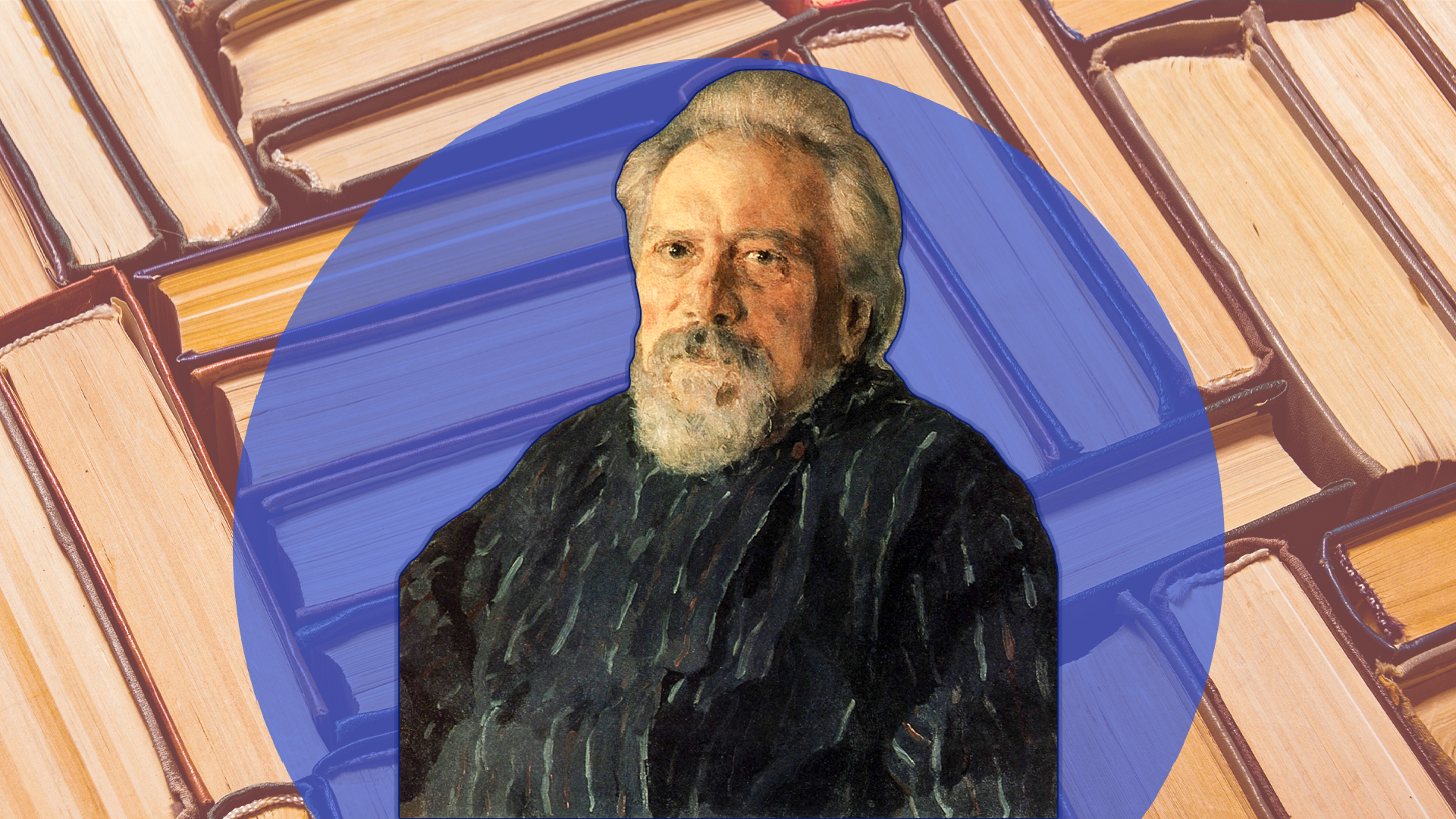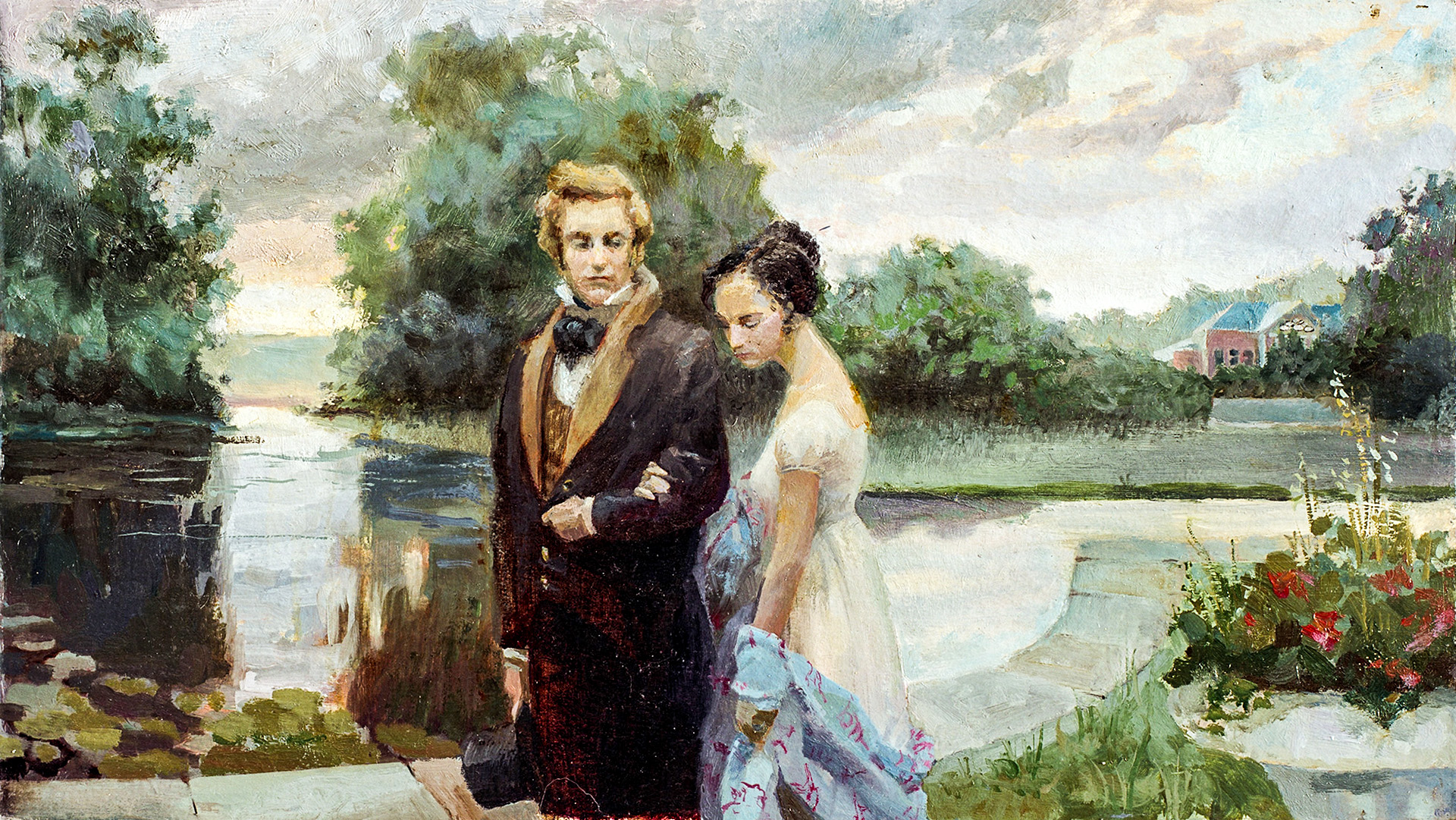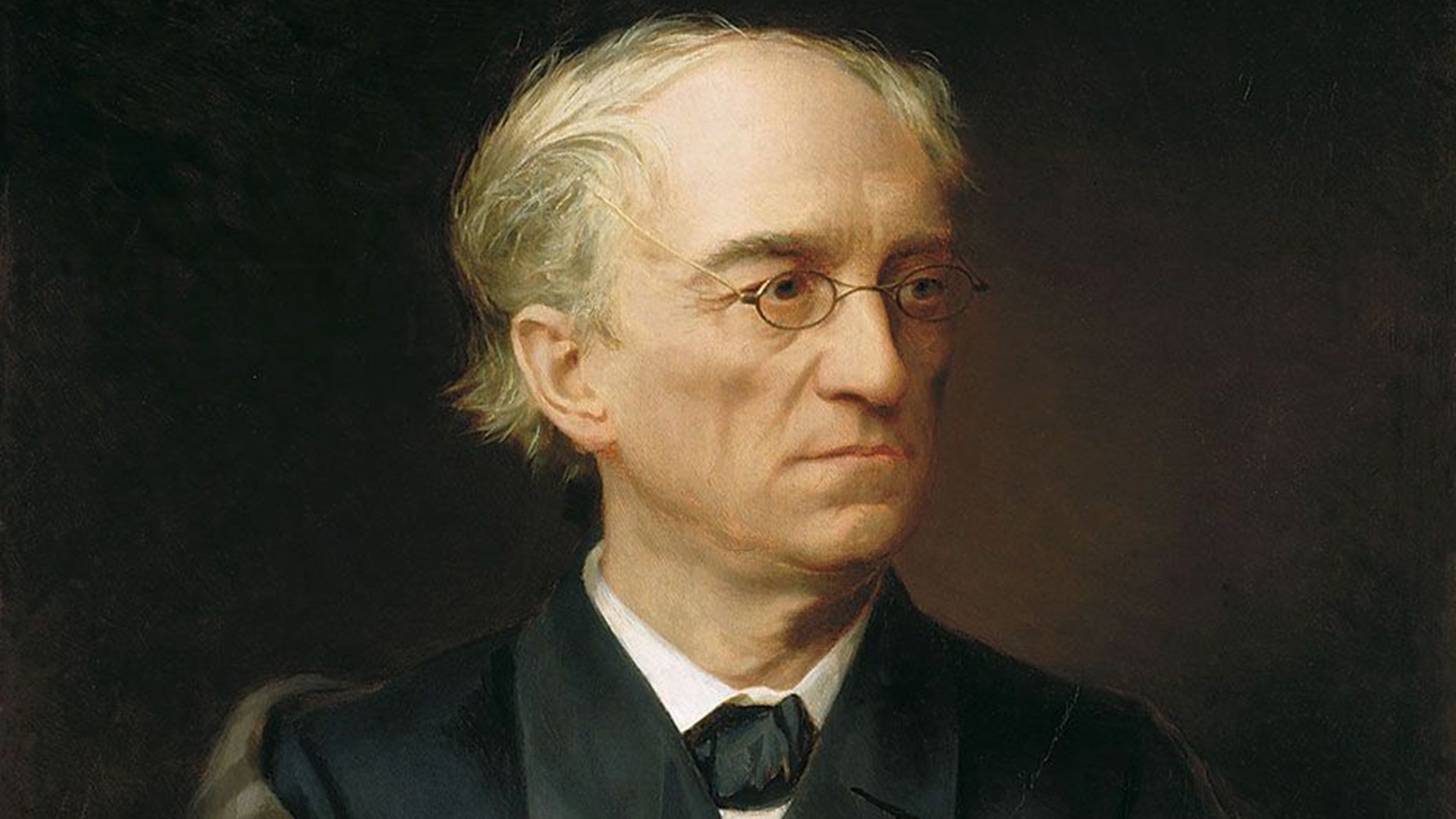Dix livres soviétiques incontournables sur la Seconde Guerre mondiale

Outre sur Telegram, Fenêtre sur la Russie diffuse désormais du contenu sur sa page VK! Vidéos, publications dédiées à l’apprentissage du russe et plus encore dans notre communauté
1. Alexandre Tvardovski, Vassili Tiorkine. Livre sur un combattant (1942-1945)

Le personnage de Tiorkine réunit en lui toutes les qualités des soldats soviétiques : gai, aimant être en bonne compagnie et chanter avec ses camarades d’armes, intrépide, plein d’abnégation. Chaque chapitre du poème raconte un épisode de la vie sur le front inspiré de ce dont l’auteur, correspondant de guerre, avait été témoin.
La forme du poème rappelle une épopée populaire ou des contes russes. En dépit du fait qu’Alexandre Tvardovski ne mentionne jamais ni le Parti communiste, ni le nom de Joseph Staline, la censure ne trouva rien à redire à ce livre qui connut un très grand succès.
2. Valentin Kataïev, Le Fils du régiment (1944)

Vladimir Kataïev est le premier écrivain soviétique qui décida de montrer la guerre à travers le regard d’un enfant. Durant la Grande Guerre patriotique, de nombreux orphelins se retrouvèrent dans le milieu de l’armée et certains devinrent des « enfants du régiment ». On ne sait pas exactement qui fut l’enfant qui servit de prototype au héros de Valentin Kataïev.
La nouvelle raconte l’histoire de Vania Solntsev. Il est orphelin de père et de mère et est découvert par des soldats d’un groupe de reconnaissance. L’enfant veut rester avec les soldats sur le front. Alors qu’on l’emmène à l’arrière, il s’enfuit. Sa persévérance finit par payer : les soldats l’autorisent à rester avec eux et même à les accompagner dans des opérations.
3. Alexandr Fadeïev, La Jeune Garde (1946)


Ce roman est inspiré de faits réels et raconte l’histoire de l’organisation clandestine de la Jeune Garde qui menait des actes de résistance aux nazis en zones occupées. Beaucoup de ses membres furent capturés, suppliciés et exécutés par les Allemands. Aucun d’eux ne parla sous la torture.
Alexandre Fadeïev recueillit les récits de témoins. La première version de son roman sortit en 1946 et fut critiquée par Joseph Staline qui lui reprochait de ne pas suffisamment mettre en relief le rôle du parti communiste dans les activités de cette organisation clandestine de jeunes. Alexandre Fadeïev, qui était l’un des principaux relais de l’idéologie du régime soviétique et le secrétaire de l’Union des écrivains de l’URSS, révisa considérablement son texte. La seconde version parut en 1951 et fut incluse dans le programme scolaire de littérature.
4. Viktor Nekrassov, Dans les tranchées de Stalingrad (1946)

Un architecte, mobilisé comme ingénieur dans une unité du génie, participe à la bataille de Stalingrad. Ce texte autobiographique parut immédiatement après la fin de la guerre dans la revue Znamia (L’Étendard) et fit beaucoup de bruit. Viktor Nekrassov, qui n’était pas encore un écrivain professionnel, ne pensait pas être publié. Joseph Staline lut sa nouvelle et lui fit attribuer le Prix Staline en 1947.
De nombreux écrivains de métier apprécièrent le récit de Viktor Nékrassov à sa juste valeur. Il fut le premier à être qualifié de « prose des lieutenants », un genre qui montrait la « vérité des tranchées » et incita beaucoup d’anciens combattants à coucher leurs souvenirs de guerre sur le papier.
5. Boris Polievoï, Histoire d’un homme véritable (1946)

Ce livre raconte l’histoire du pilote et Héros de l’Union soviétique Alexeï Meressiev. En mars 1942, son avion fut abattu et s’écrasa dans une forêt. Les deux jambes cassées, il rampa dix-huit jours durant sur le sol gelé avant de trouver âme qui vive. Il fut amputé des deux pieds. Un an plus tard, il était de nouveau aux commandes d’un chasseur et descendit deux avions ennemis lors d’une de ses premières sorties.
Cette histoire est vraie (à l’exception du nom du pilote qui fut légèrement modifié). Boris Poliévoï, qui était correspondant de guerre, fit la connaissance du prototype de son personnage, Alexeï Maressiev, lorsque celui-ci avait été réintégré dans l’active.
À l’époque soviétique, l’exploit d’Alexeï Maressiev était connu de tous, en particulier des écoliers. Le récit de Boris Polievoï fut porté à l’écran et Sergueï Prokofiev en fit un opéra.
6. Vassili Grossman, Vie et Destin (1950-1959)

Ce roman est inspiré de la vie de son auteur. Vassili Grossman fut longtemps correspondant de guerre et fut témoin de la bataille de Stalingrad. Il décrivit la vie en évacuation, les répressions, comment les amis et voisins tournaient le dos aux parents des personnes victimes des répressions. Il vit l’extermination de juifs par les nazis (sa propre mère mourut sous occupation allemande).
L’épopée de Vassili Grossman est aujourd’hui considérée comme le Guerre et Paix du XXe siècle. Mais, à l’époque soviétique, son manuscrit fut confisqué et il fut interdit de publier son texte sous prétexte d’une critique du régime stalinien (et même d’une comparaison entre Joseph Staline et Adolf Hitler). Vassili Grossman avait pu faire parvenir une copie de son manuscrit à l’étranger. Son roman fut édité en Suisse en 1980 et en URSS durant la Perestroïka en 1988.
7. Mikhaïl Cholokhov, Le Destin d’un homme (1956-1957)

Mikhaïl Cholokhov, prix Nobel de Littérature pour son épopée sur la guerre civile Le Don Paisible, est également l’auteur d’une des nouvelles les plus émouvantes qui soient sur la Grande Guerre patriotique. Il tenait cette histoire d’un homme dont il avait fait la connaissance par hasard. En 1959, Sergueï Bondartchouk la porta à l’écran. La même année, ce film, qui fut la première réalisation de l’acteur, fut récompensé du grand prix lors de la 1ère édition du Festival International du film de Moscou.
Cette histoire est celle du chauffeur Andreï Sokolov qui part pour le front, est fait prisonnier par les Allemands et envoyé en camp de concentration. Il parvient à s’enfuir. Il sait que sa femme et sa fille ont été tuées et qu’il ne lui reste que son fils. Dans les derniers jours du conflit, il apprend que ce dernier est mort au combat. Après la fin de la guerre, il rencontre un enfant orphelin et décide de lui dire qu’il est son père. Une nouvelle vie commence pour eux deux.
8. Constantin Simonov, Les Vivants et les Morts (1959-1971)

Constantin Simonov est l’auteur du poème le plus poignant sur la Grande Guerre patriotique Attends-moi et je reviendrai. Son épopée Les Vivants et le Morts n’impressionna pas moins ses lecteurs. Cette trilogie couvre la période allant de l’été 1941 à l’été 1944.
L’écrivain y décrit les destins d’hommes et de femmes brisés par la guerre. Le personnage principal est le correspondant de guerre Ivan Sintsov. Il est pris dans une poche d’encerclement, blessé, perd des proches et subit d’autres épreuves imposées par la guerre. Constantin Simonov fut lui-même correspondant de guerre durant le second conflit mondial. Si la trame de son roman est inventée, nombre de ses personnages sont inspirés de victimes des horreurs de la guerre.
9. Boris Vassiliev, Ici, les aubes sont calmes (1969)

Cinq jeunes femmes, canonnières de DCA, et leur officier font face à des soldats de reconnaissance allemands dans les forêts de Carélie. Privés de liaison avec leur commandement, ils doivent prendre leurs décisions seuls. Le sujet de cette nouvelle est inspiré de l’histoire de soldats qui, sans avoir reçu l’ordre de le faire, résistèrent jusqu’à la mort pour empêcher l’ennemi d’avancer.
Boris Vassiliev était parti sur le front en tant qu’engagé volontaire dès les premiers jours de la guerre. Il y vit la mort de près à plusieurs reprises. Sa nouvelle connut beaucoup de succès. Elle fut adaptée à l’écran en 1972 et en 2015 et au théâtre où elle est régulièrement donnée.
10. Daniil Granine et Alès Adamovitch, Livre du blocus (1977-1982)

Il n'y a pas de scènes de bataille dans ce livre. Sa lecture n’en glace pas moins le sang. Daniil Granine et Alès Adamovitch y compilèrent les témoignages de deux cents habitants de Léningrad, ville que le siège allemand coupa du reste du monde et condamna à près de 900 jours de souffrance.
La publication de ce livre qui présentait une vérité dérangeante de la guerre fut longtemps interdite. Elle ne fut autorisée qu’à l’époque de la Perestroïka.
Dans cette autre publication, découvrez cinq films soviétiques qui ont montré la Seconde Guerre mondiale sous un jour nouveau.