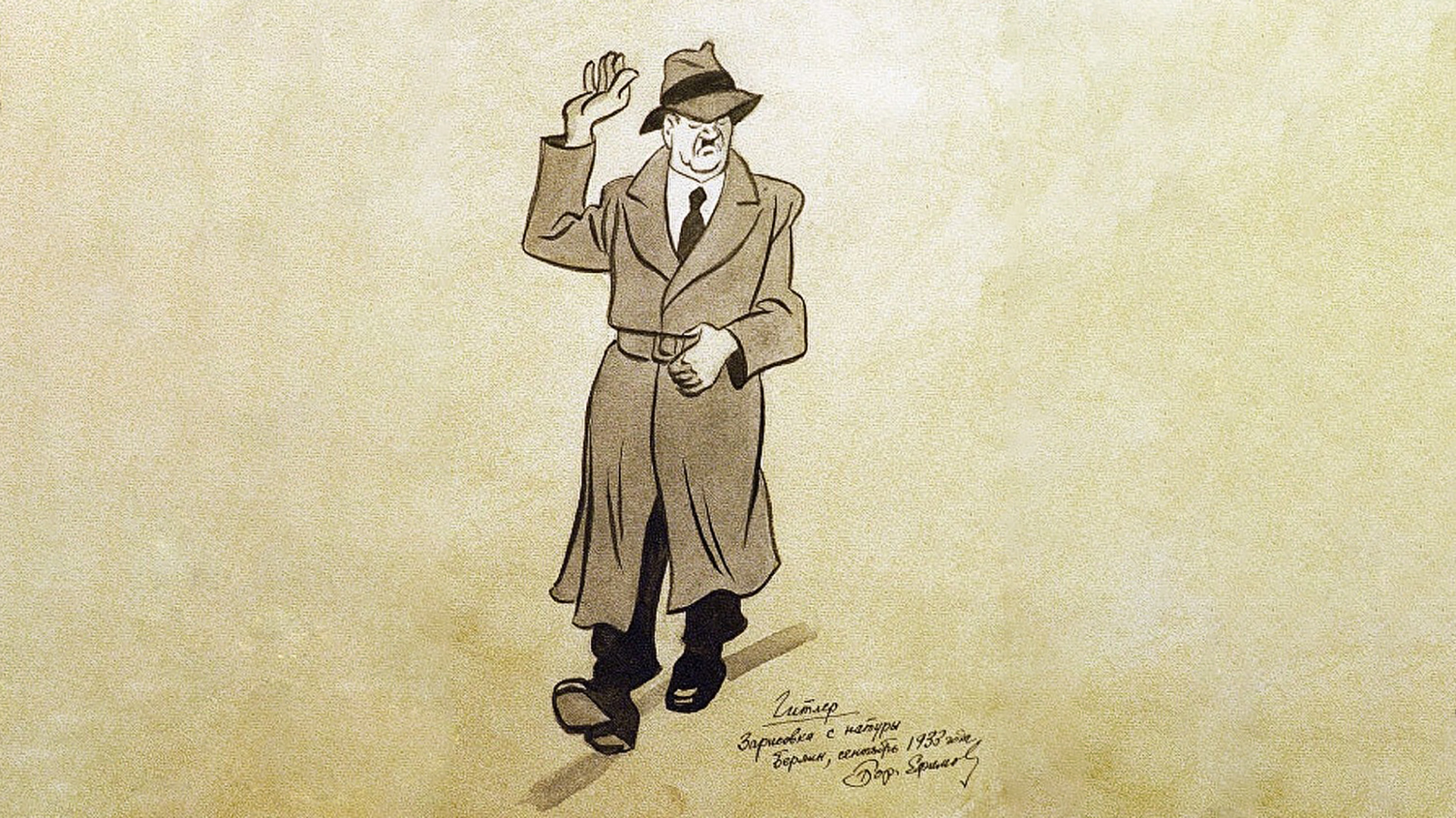Que se passe-t-il sur la peinture Repas monastique de l’artiste Vassili Perov?

Outre sur Telegram, Fenêtre sur la Russie diffuse désormais du contenu sur sa page VK! Vidéos, publications dédiées à l’apprentissage du russe et plus encore dans notre communauté
Les œuvres de cet artiste talentueux étaient appréciées pour leur vérité vivante, mais dans certains domaines, elles ne rencontraient absolument pas l’approbation. Tout d’abord, celle du clergé. Le maître ne faisait aucune concession au sacerdoce et représentait les ecclésiastiques de manière aussi impartiale que les autres : policiers, paysans, propriétaires terriens. Les religieux n’étaient donc pas enthousiastes à ce sujet.
Réalisme immoral

En 1861, l’artiste présenta à l’Académie des arts de Saint-Pétersbourg deux tableaux représentant des prêtres. Le premier, Prédication dans un village, lui valut une grande médaille d’or. Le second, Procession villageoise de Pâques, provoqua un scandale. La raison en était le réalisme avec lequel Perov avait représenté les célébrations pascales. La boue impraticable sous les pieds des marcheurs, l’icône renversée dans les mains d’un vieillard, le prêtre ivre qui tient à peine debout et le paysan qui dort d’un sommeil profond sous le porche... Le tableau fut retiré de l’exposition de la Société pour la promotion des arts et il fut interdit de le montrer ou de le reproduire à l’avenir. Le célèbre mécène moscovite Pavel Tretiakov, qui l’avait acheté et qui, sans crainte, l’avait exposé dans sa galerie, fut aussi averti : bientôt, le Saint-Synode s’intéresserait à la raison pour laquelle il avait acheté un tableau immoral.
Lire aussi : Concierge louant un appartement à une gente dame: que se passe-t-il dans ce tableau de Perov?
Les limites du bien et du mal

Perov n’a pas abandonné le thème qu’il avait choisi et a continué à créer des œuvres qui exprimaient à la fois la tristesse face à la situation humiliante des gens et la foi en un changement possible de la situation. Lors d’un voyage en Europe avec sa pension, il a décidé de peindre un tableau représentant une scène de la vie monastique. Cependant, le travail a pris du temps. Au printemps 1866, l’artiste a annoncé qu’il espérait terminer le tableau Repas monastique pendant l’hiver et qu’il prévoyait de le présenter au Conseil de l’Académie des arts.

Il a ainsi représenté un repas monastique : des prêtres sont assis à une table somptueusement dressée. Des serveurs s’affairent autour d’eux : l’un se dépêche d’apporter un plat de poisson cuit au four, l’autre se hâte d’ouvrir une nouvelle bouteille, pressé par l’un des convives. Les convives se livrent sans vergogne à la gloutonnerie : certains décident même d’emporter de la nourriture avec eux et versent des huîtres de leur assiette dans un mouchoir. Une marchande corpulente vêtue d’une robe violette, qui a payé ce repas, est conduite à la table comme une invitée d’honneur. Cette scène est d’autant plus répugnante que l’on remarque qu’une mendiante assise par terre avec ses enfants tend la main vers la bienfaitrice. Or, personne ne prête attention à eux, ni au prêtre prosterné devant les convives, espérant sans doute qu’on lui proposera de se joindre au repas.

Les moines assis à la table voisine observent ce festin avec étonnement et dégoût. Leur repas est beaucoup plus modeste : pas de vin à profusion ni de mets exotiques. À côté, l’un des frères continue de prier, sans prêter attention à ce qui se passe autour de lui.

Lire aussi : Les dix peintures russes les plus effrayantes
Un espoir existe
Dans son tableau, Perov a représenté tout un bouquet de péchés capitaux : non seulement la gourmandise, mais aussi l’orgueil, la cupidité, l’envie. Il semble que « les frontières entre le bien et le mal se soient effacées et aient disparu ». Néanmoins, les rayons du soleil qui pénètrent par les fenêtres éclairent la table « vide » et les moines assis autour d’elle, ainsi que le prêtre en prière devant la Bible, comme s’ils donnaient l’espoir d’une renaissance spirituelle.
C’est également ce qu’évoque l’oiseau qui vole au-dessus de sa tête, symbole du Saint-Esprit. S’il n’a pas encore quitté ces murs, il faut croire que tout va changer.
L’artiste utilise également comme indices des citations évangéliques inscrites sur les murs du réfectoire : « Lazare, sors », « Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés », « Que votre cœur ne se trouble point ; croyez en Dieu, croyez aussi en moi ». Il invite ainsi les spectateurs à garder la foi.
Le retour au public du Repas monastique, où Perov « a représenté le festin offert aux moines par une marchande, tel qu’il l’avait vu dans la nature, n’a pas été autorisé à l’époque », a noté la publication de l’époque Vestnik iziachtchikh iskousstv (Le Bulletin des beaux-arts). Il était même interdit de photographier le tableau. En 1875, l’artiste y apporta par conséquent des modifications, mais la toile ne fut tout de même exposée qu’après sa mort, 16 ans après qu’il eut terminé son travail. En 1882-1883, une grande exposition des œuvres de Perov eut lieu à Moscou et à Saint-Pétersbourg, où le public vit pour la première fois le Repas monastique.
Dans cet autre article, découvrez ce que montre Ilia Répine sur son tableau Les Bateliers de la Volga.