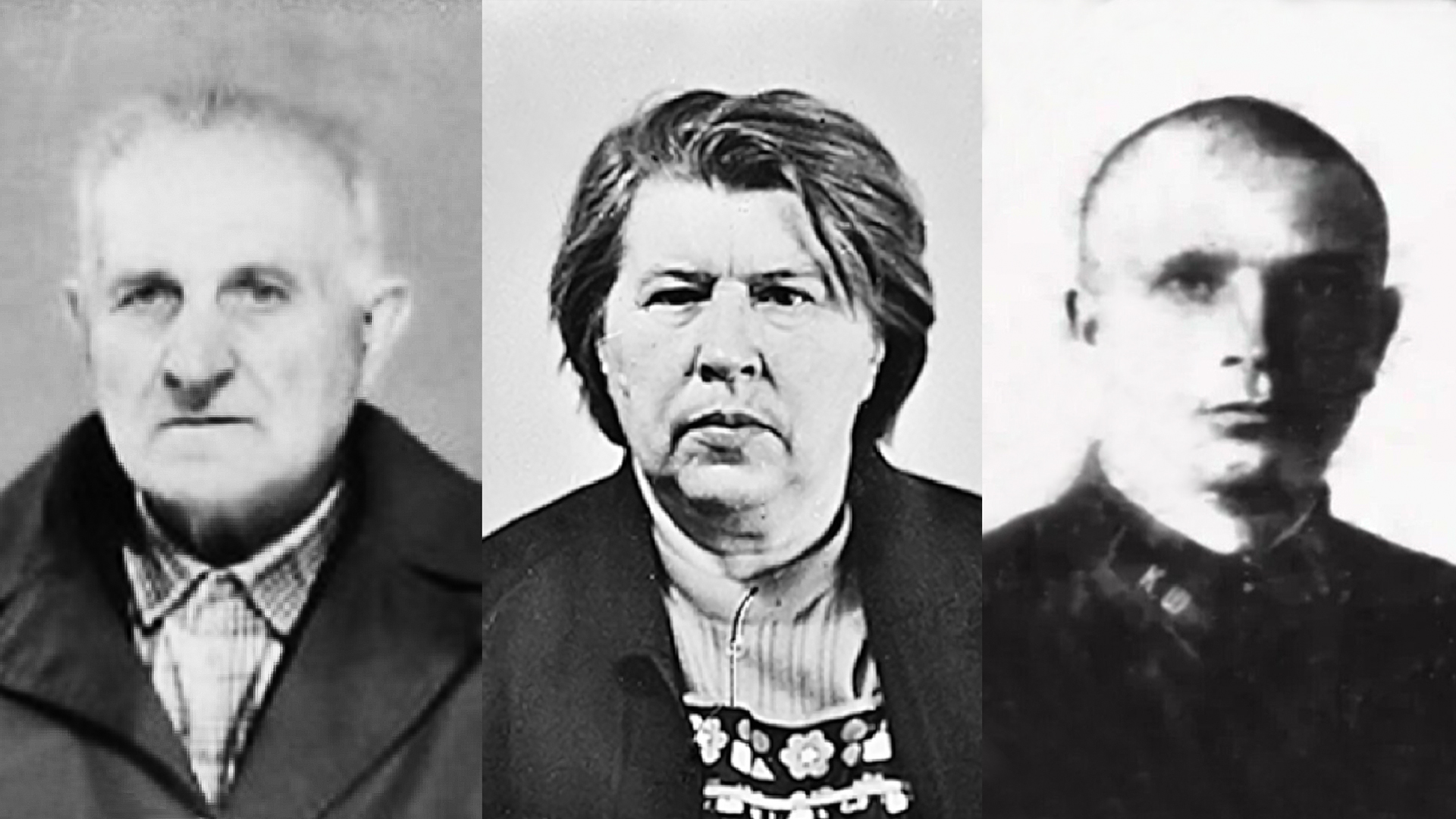Comment l’Armée rouge défendit-elle le Caucase contre la Wehrmacht?

Outre sur Telegram, Fenêtre sur la Russie diffuse désormais du contenu sur sa page VK! Vidéos, publications dédiées à l’apprentissage du russe et plus encore dans notre communauté
En mai 1942, l’Armée rouge fut cruellement défaite à Kharkhov (Urkaine soviétique). Les Allemands profitèrent de la faiblesse de leur adversaire et, le 28 juin, lancèrent l’opération Fall Blau pour se rendre maîtres des champs pétrolifères du Caucase.
À cette époque, la plus grande partie du pétrole soviétique provenait des gisements du Caucase du Nord et de la République socialiste soviétique d’Azerbaïdjan. Les contrôler aurait permis au Troisième Reich de régler la question de son approvisionnement en pétrole et de porter un coup très sérieux à la capacité de combat de l’Armée rouge.
 Troupes allemandes pendant la bataille du Caucase (opération Fall Blau)
Troupes allemandes pendant la bataille du Caucase (opération Fall Blau)
Le 25 juillet 1942, une partie du groupe d’armées A traversa le Don et la bataille du Caucase s’engagea. Le groupe d’armées B protégea son avancée vers la chaîne de montagnes puis se dirigea vers la Volga et Stalingrad. Cette région présentait alors moins d’importance pour les Allemands que le Caucase.
Les soldats soviétiques étaient alors 1,5 fois moins nombreux que les Allemands (2 fois moins dans l’artillerie). L’Armée rouge disposait de 8 fois moins de moyens aéroportés et de 9 fois moins de véhicules blindés que ce que la Wehrmacht avait engagé sur ce front.

« Le commandement opérationnel [...] parvint à la conclusion qu’affronter les chars ennemis dans les steppes du Kouban serait très difficile. D’autant plus que nous avions beaucoup d’éléments de cavalerie et peu de moyens anti-chars dans le Caucase du Nord. Nous n’avions pas non plus de lignes suffisamment proches pour organiser la défense », se souvenait le général Semion Chtemenko.
Après avoir mené des combats d’arrière-garde, les troupes soviétiques abandonnèrent la grande région fertile du Kouban et reculèrent jusqu’aux contreforts du Caucase où elles construisirent des défenses à la hâte. Le 9 août, la Wehrmacht entra dans Piatigorsk et, le lendemain, dans Mineralnyé Vody.
 Défense du Caucase par les soldats de l'Armée rouge
Défense du Caucase par les soldats de l'Armée rouge
Le commandement soviétique pensa longtemps que les défilés montagneux étaient infranchissables pour des unités militaires importantes. C’était pourquoi beaucoup d’entre eux n’étaient même pas gardés par des piquets.
Les chasseurs alpins allemands firent la démonstration que ce jugement était erroné. Le 21 août, des soldats de la 1ère division de montagne « Edelweiss » plantèrent des drapeaux du Troisième Reich au sommet de l’Elbrouz pour signifier qu’ils s’étaient rendus maîtres du Caucase.
 Infanterie allemande dans les montagnes du Caucase
Infanterie allemande dans les montagnes du Caucase
Les troupes allemandes et soviétiques s’affrontèrent au cours d’âpres combats pour Touapsé. Le 28 octobre, Naltchik tomba. Le 2 novembre, les Allemands étaient aux portes d’Ordjonikidzé (aujourd’hui, Vladikavkaz) et se préparaient à marcher sur Grozny. Mais, le 5 novembre, l’Armée rouge lança sa contre-offensive.
La résistance acharnée des troupes soviétiques ralentit la progression des allemandes. L’ennemi ne pouvait plus avancer sur toute la longueur du front qu’il tenait et n’était actif que sur certains tronçons de celui-ci.
 Un combat dans le Caucase du Nord
Un combat dans le Caucase du Nord
L’agent des transmissions Efim Tcherniavski se souvenait de la bataille livrée pour Malgobek, une petite ville où vivaient des ingénieurs et des ouvriers du secteur pétrolier. Elle fut prise et reprise de nombreuses fois :
« Tout était couvert d’un mélange de terre, de sang et de boue : les gens, les armes [...] J’ai transmis une nouvelle fois les informations que notre lieutenant voulait faire connaître à la division. Les katiouchas tirèrent sur les positions allemandes et touchèrent nos tranchées. [...] J’ai été fortement contusionné, ma radio a volé en éclats. J’ai rampé hors de la tranchée. Je ne voyais rien. Du sang coulait de mes oreilles. De la fumée recouvrait tout. Je me suis évanoui. J’ai repris connaissance dans un hôpital militaire trois jours plus tard ».
 Infanterie soviétique dans les montagnes
Infanterie soviétique dans les montagnes
Le 19 novembre 1942, dans la région de Stalingrad, l’Armée rouge lança l’opération Uranus. Le groupe d’armées allemand B eut alors urgemment besoin de réserves. Dans le Caucase, les Soviétiques essayaient de contenir leur ennemi pour qu’il ne puisse projeter de renforts vers la Volga.

Le 1er janvier 1943, les armées soviétiques qui protégeaient le Caucase passèrent à l’offensive. Elles avaient désormais l’avantage : 1,5 fois plus d’hommes, presque 2 fois plus d’armes d’artillerie, d’avions et de chars.
À la mi-janvier, elles avaient libéré Mineralnyé Vody, Piatigorsk et Kislovodsk. Le 21 janvier, elles reprirent Stavropol. Au début du mois de février, des soldats de la 46ème armée mirent à bas les drapeaux du Troisième Reich qui flottaient sur l’Elbrouz et y plantèrent des soviétiques.
 Mitrailleur allemand sur le front de l'Est, 1943
Mitrailleur allemand sur le front de l'Est, 1943
Le commandement de l’Armée rouge envisageait de prendre en tenailles le groupe d’armées allemand A, comme la 6ème armée de Friedrich Paulus l’avait été à Stalingrad. Mais, les Allemands battirent en retraite suffisamment rapidement pour éviter d’être encerclés.
Ils reculèrent sur la « ligne bleue », des positions déjà préparées sur la péninsule de Taman. Durant le printemps et l’été 1943, les Soviétiques essayèrent en vain de l’enfoncer.
 L'as soviétique Alexandre Pokrychkine dans le Caucase du Nord
L'as soviétique Alexandre Pokrychkine dans le Caucase du Nord
En avril et juin 1943, les forces aériennes soviétiques et la Luftwaffe s’affrontèrent dans le ciel du Kouban. Elles engagèrent chacune jusqu’à 2 000 avions. Les Soviétiques remportèrent une victoire éclatante sur leur ennemi.
Durant la première moitié du mois de septembre 1943, à l’issue de combats sanglants, l’Armée rouge brisa les défenses allemandes sur la « ligne bleue » et les obligea à reculer sur la péninsule de Crimée. Le 9 octobre, celle de Taman était totalement libérée. Cette victoire marqua la fin de la bataille du Caucase.
 Les troupes soviétiques entrent dans Novorossiïsk libérée.
Les troupes soviétiques entrent dans Novorossiïsk libérée.
Dans cette autre publication, découvrez dix livres soviétiques incontournables sur la Seconde Guerre mondiale.