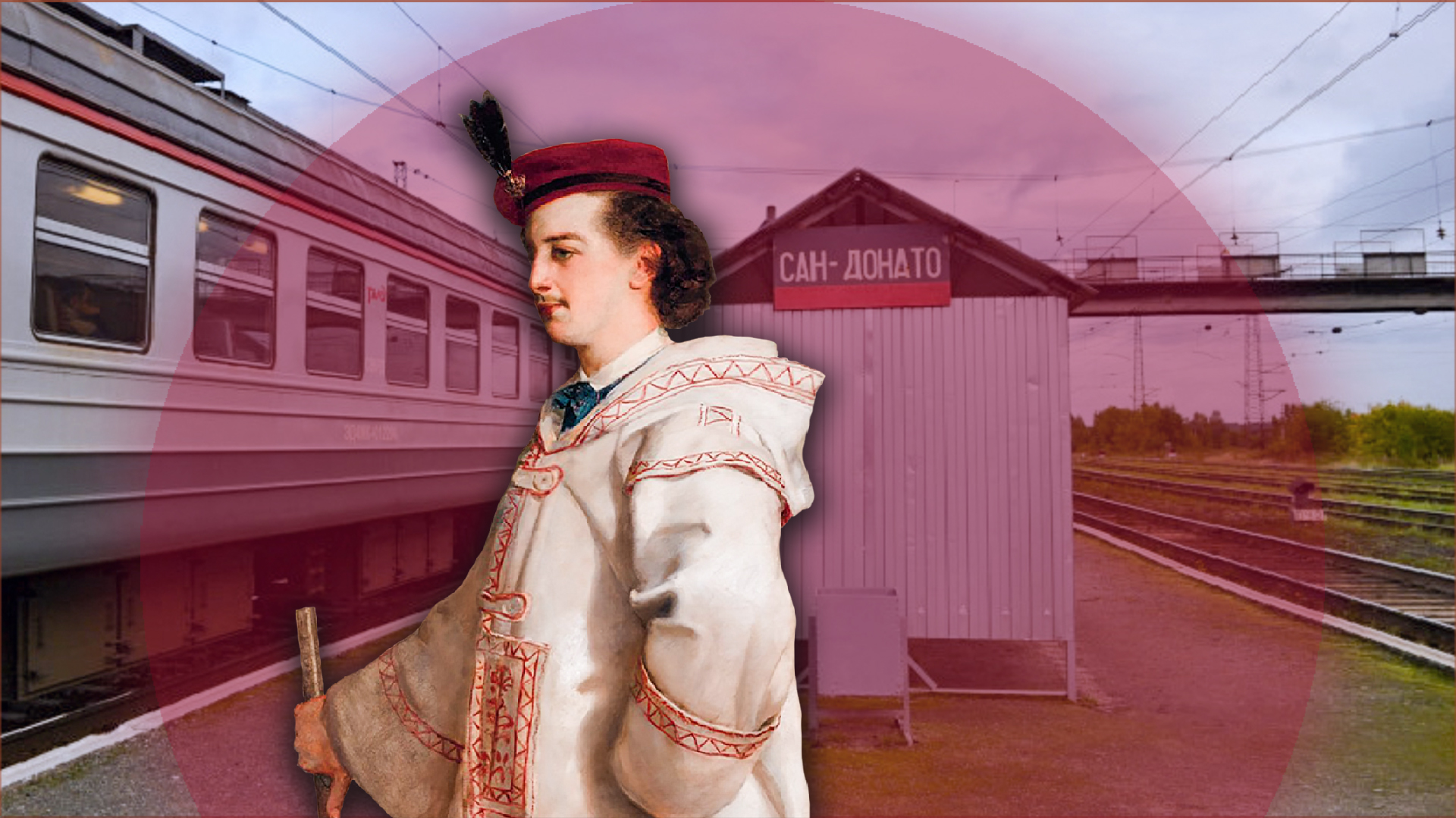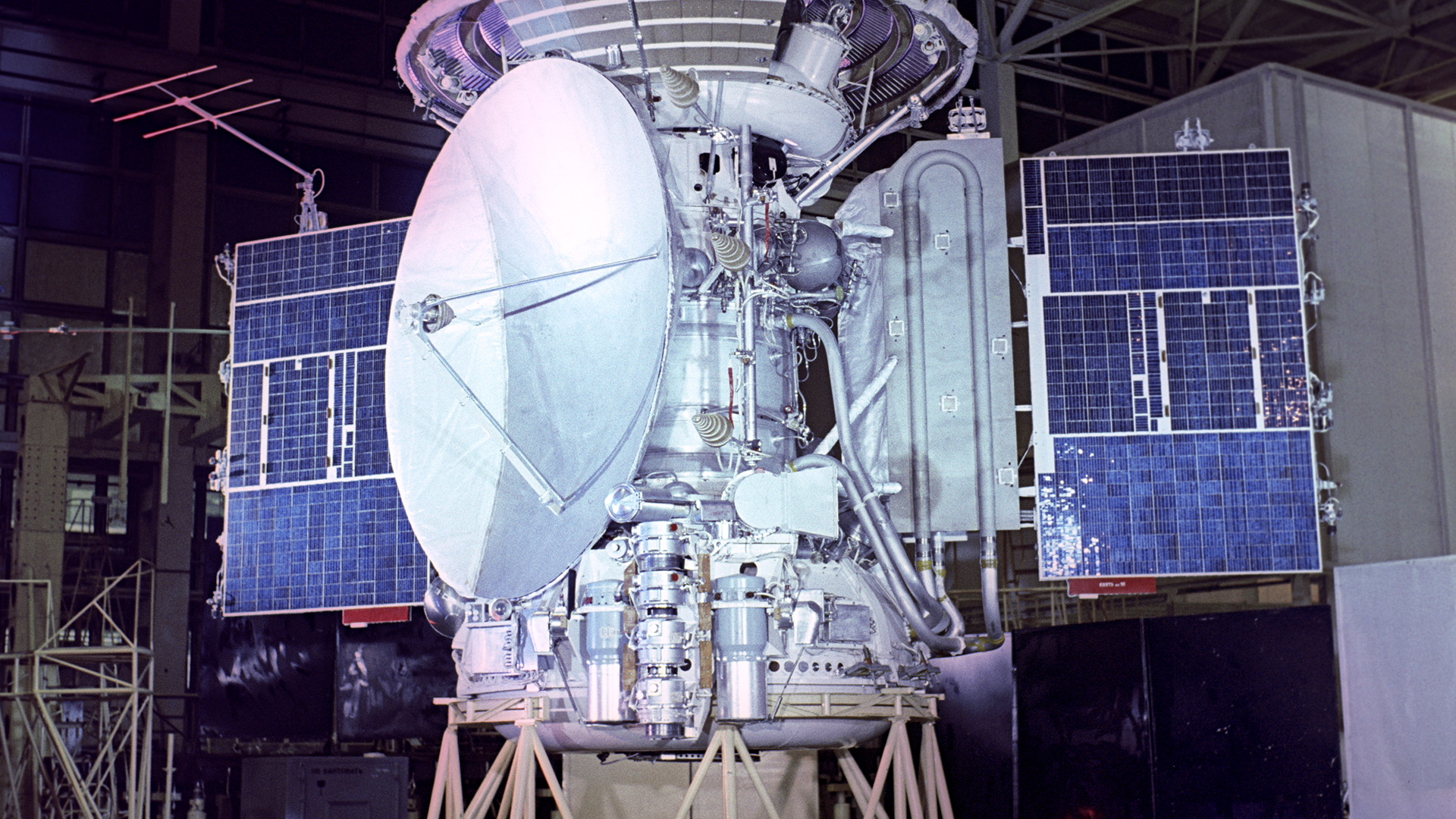Comment une institutrice de campagne sauva-t-elle 3.225 enfants durant la Grande Guerre patriotique?

Outre sur Telegram, Fenêtre sur la Russie diffuse désormais du contenu sur sa page VK! Vidéos, publications dédiées à l’apprentissage du russe et plus encore dans notre communauté
Le 14 août 1942, un convoi d’une soixantaine de wagons de marchandises entrait en gare de Gorki (aujourd’hui, Nijni-Novgorod). Il évacuait des gens affamés et exténués. Parmi eux, des enfants natifs de la région de Smolensk qui avaient échappé aux bombes et obus allemands. Pour survivre, ils avaient dû quitter leurs familles et leur région alors ravagée par d’âpres combats. Les Allemands n’épargnaient pas la population civile : ils brûlaient les villages, torturaient et mettaient à mort les proches des communistes et ceux qu’ils soupçonnaient de venir en aide aux partisans.
Évacuer ces enfants à l’arrière était le seul moyen de leur éviter la mort ou la déportation en camps de concentration. Nikifor Koliada, connu comme Batia, commandant du plusieurs unités de partisans, confia cette difficile tâche à Matriona Volskaïa, institutrice à l’école de Bassino. Il ne savait pas que celle qu’il connaissait comme une combattante réfléchie et un excellent agent de renseignement était alors enceinte. À cette époque, la jeune femme avait déjà été décorée de l’ordre de l’Étoile rouge pour avoir réussi une opération avec des partisans. Nikifor Koliada ne put lui déléguer que deux autres résistantes : l’institutrice Varvara Poliakova et l’infirmière Ekaterina Gromova. Il leur incombait à elles trois d’assurer l’évacuation de centaines d’enfants.
Marche
Le 23 juillet 1942, environ 1 500 enfants furent rassemblés sur la place du village d’Elisseïevitchi. Ils avaient tous au moins 10 ans. Les plus âgés en avaient 16-17. Les partisans savaient que les enfants de moins de 10 ans ne pourraient pas faire 200 kilomètres sur des routes défoncées, à travers champs et marécages, dans une zone proche du front qu’aucun des belligérants ne tenait vraiment. Il fallait s’attendre à tout moment à ce que les Allemands n’y passent à l’attaque.
« C’était terrifiant, témoigna plus tard Varvara Poliakova. Pas pour nous-mêmes, mais pour eux [les enfants – ndlr]. Il nous fallait comprendre comment leur faire faire ce trajet dangereux ».

Lire aussi : Ces Russes qui ont sauvé, au péril de leur vie, des enfants juifs de l'Holocauste
Les résistantes formèrent des groupes de 40 à 50 enfants et désignèrent parmi eux des agents de liaison. Matriona Volskaïa prit la tête de la colonne avec les plus âgés. Venaient ensuite Varvara Poliakova avec de plus jeunes. L’infirmière Gromova accompagnait les plus petits en queue de colonne. Ils marchèrent 6 jours durant. La nuit, ils se cachaient dans des forêts. Matriona Volskaïa partait alors en éclaireur sur 20-25 kilomètres pour s’assurer que le chemin qu’ils allaient emprunter n’était pas miné et qu’il n’y avait pas d’Allemands. Au matin, elle retrouvait les enfants et reprenait la route avec eux.
Il faisait une chaleur écrasante. Ils ne pouvaient pas boire l’eau qu’ils trouvaient : les puits et la rivière Gobzy étaient empoisonnés par les cadavres que les Allemands y jetaient. Lorsqu’ils virent la Dvina occidentale, les enfants quittèrent le refuge que leur procurait la forêt et se précipitèrent vers l’eau. Trois chasseurs allemands qui les aperçurent ouvrirent le feu sur eux. Les enfants se dispersèrent. Seul un chariot sur lequel se trouvait la jeune Jenia Alekhnovitch, qui était affaiblie, resta sur la rive. L’enfant fut la seule blessée dans cette attaque.
3 225 vies
Au fur et à mesure que la colonne emmenée par Matriona Volskaïa avançait, des enfants des villages près desquels elle passait venir la grossir. Lorsqu’elle atteint Toropets, ce furent environ 1 000 enfants de plus qui la rejoignirent. Ils attendirent le train plusieurs jours dans les bâtiments d’une ancienne école et d’un club à moitié détruit.
Les enfants embarquèrent dans la nuit du 4 au 5 août. La colonne d’enfants s’étira le long de la soixantaine de wagons dans lesquels ils se hissèrent. Sur le toit des wagons avait été écrit en lettres énormes ДЕТИ (diéti / enfants).
Lire aussi : Cette femme ayant vaincu la criminalité dans l’un des plus dangereux quartiers de Leningrad
À la gare de Gorki, les enfants furent accueillis par des responsables locaux et des médecins. Si beaucoup d’entre eux furent évacués sur des civières, Matriona Volskaïa, Varvara Poliakova et Ekaterina Gromova étaient parvenues à les garder en vie. Des témoins rapportèrent qu’elles avaient sauvé 3 225 enfants en leur permettant de rejoindre l’arrière.

Ils furent pris en charge dans des hôpitaux civils et militaires. Ils furent ensuite envoyés en apprentissage puis en usines. Matriona Volskaïa fut assignée à l’école du village de Smolki dans la région de Gorki. Elle accoucha bientôt d’un fils. Son mari Mikhaïl Volski, également membre du mouvement des partisans, put les rejoindre plus tard. Elle continua d’enseigner dans les petites classes, eut un second fils. Elle parlait très rarement de l’évacuation héroïque des enfants qu’elle avait réussie en 1942.

Cet article est une version abrégée de celui publié en russe dans le magazine Le Monde Russe.
Dans cette autre publication, nous vous présentons Enfants de la guerre, peinture soviétique reflétant l’amertume de la vie derrière le front Est.